6 août [1850], mercredi matin, 7 h. ½
Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon cher adoré, comment as-tu passé la nuit ? Comment vas-tu ce matin ? Voilà pourtant plus de huit jours que tu es souffrant, mon pauvre amour, et depuis ces huit jours, si longs et si tristes, je t’ai vu deux fois et pas une demi-heure en tout [1]. Aussi, mon cher adoré, ai-je bien besoin de savoir comment tu vas et quand je te verrai ? Hier je n’ai pas voulu me coucher avant d’avoir fait ma paix avec toi. Je souffrais trop de t’en vouloir, même à ton insua. Je n’aurais pas pu passer une seconde nuit comme celle d’avant-hier, je souffrais trop. Aujourd’hui, sans avoir l’affreuse amertume d’hier, je suis triste et tourmentée. Ce temps hideux et malsain m’inquiète. J’ai peur qu’il ne prolonge indéfiniment ton état de souffrance et les précautions qu’il exige. Qu’est-ce que je deviendrais s’il fallait rester encore longtemps sans te voir ? Je n’ose pas y penser dans la crainte de me laisser aller à un chagrin atroce. Comment vas-tu ce matin, mon pauvre amour, et comment m’aimes-tu ? Désires-tu me voir ? Es-tu triste et malheureux de notre séparation ? Me plains-tu et me regrettes-tu ? Tu me le dis dans tes adorables lettres mais j’ai besoin que tu me le dises encore, sinon pour y croire, puisque je le crois, mais pour me donner du courage, de la résignation et de la patience pour attendre ton retour. Cher adoré, je suis bien profondément triste ce matin car je crains que tu ne puisses pas venir tantôt. Je te baise, je t’aime, je te désire, je t’attends, je t’adore plus que de toutes mes forces et de tout mon cœur.
Juliette
BnF, Mss, NAF 16368, f. 245-246
Transcription d’Anne Kieffer assistée de Florence Naugrette
a) « insçu ».
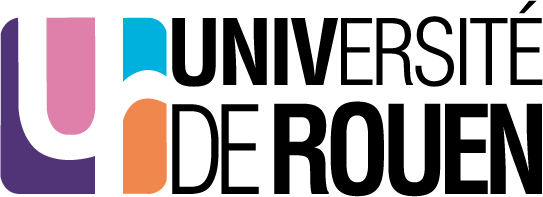






 Recevez les lettres de Juliette
Recevez les lettres de Juliette